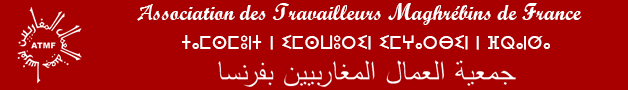A toutes les victimes du drame, avec une pensée émue à toutes celles et tous ceux qui vivent, depuis le mardi 27 dernier un véritable enfer sur terre.
Avec mes remerciements les plus sincères à toutes les personnes qui m’ont servi de guides, éclairés de leurs témoignages et gratifiés de leur confiance…
Quand toute une société tremble…
Al Hoceïma, du 27 au 29 février 04
Vendredi 27 février 04
Il est 10 heures ce vendredi et le voyage Bruxelles-Oujda aura duré exactement 14 heures, après mille péripéties liées officiellement à des contraintes météorologiques forçant l’équipage à une escale à Fès! Sur la route qui mène de Oujda à Al Hoceima, dès l’entrée dans la ville de Nador, l’effervescence d’une région en proie à une situation «extra-ordinaire» est palpable. Entre Driouch et Tiztoutine, la route se couvre brusquement d’un convoi impressionnant de camions kakis, bondés de militaires. Un peloton d’une cinquantaine de véhicules, sans compter les jeeps et les motards d’accompagnement.
A Nador, un camion arbore fièrement des drapeaux marocains. Un groupe d’hommes se démènent pour le remplir et le bâcher tandis qu’un calicot terminera la tâche «les habitants de Nador contribuent à l’aide pour la ville d’Al Hoceima». A Beni Bourayach, située à une vingtaine de kilomètres de la ville d’Al Hoceima, une longue file de manifestants (uniquement des hommes), solidement encadrée par des citoyens défilent, dans le calme et l’organisation tout en brandissant des calicots revendicateurs : «Nous sommes dehors. Et les tentes ?», «Beni Bourayach, en danger»… Après le pont, à la hauteur du marché, les commerçants sont affairés ; l’ensemble des magasins sont littéralement pris d’assaut pour l’achat de bâches en plastique, vendues au métrage, qui serviront à l’édification de tentes de fortune. Le prix de ce plastique au mètre est passé de 6 dirhams (0.6 euros) à 30 dirhams (3 euros), après le tremblement de terre.
Dès l’entrée de la ville à Al Hoceima, sur le bord de la route, le spectacle est impressionnant. L’ampleur des dégâts est considérable ; des maisons éventrées, abandonnées par leurs habitants sont remplacées par de petites huttes en plastique qui font office d’abris de fortune. Les femmes se sont visiblement déjà organisées, pour que la vie puisse reprendre son cours. Elles s’affairent à l’extérieur, pendent le linge sur des fils tendus d’une tente à l’autre, cuisinent sur des petits gaz de camping.
Après une visite rapide à la famille, je me rends immédiatement à Imzouren, dans le cœur de la ville. Ici le spectacle est encore plus terrifiant que sur le fronton de route. La ville est déserte, les maisons qui tiennent encore debout semblent avoir été la proie d’intenses bombardements. Quant à celles qui ont été détruites, elles s’amoncellent, tas de gravats, de carrelages, d’armatures en fer, de vaisselle, de literies, de meubles… Dans ma mémoire, les images enregistrées à Jenine et celles-ci s’entrechoquent. Je cherche en vain des témoins. Impossible. L’entièreté des habitants se sont réfugiés sur une esplanade en dehors du cœur de la ville et sur la place du marché.
Saïd Androuss, l’architecte qui m’accompagne m’explique que nombre de ces maisons sont construites par des «immigrés» et ne sont donc habitées qu’à leur retour. C’est ce qui explique le nombre de décès particulièrement peu élevé, en regard des destructions (140 personnes si l’on en croit les chiffres qui me sont remis), et en comparaison avec des bourgades rurales un peu plus éloignées. L’architecte fustige les constructions qui ont été construites, sans respect des normes architecturales. «Regardez, ici nous sommes dans une zone dénommée HB3, ce qui entend qu’aucun immeuble ne peut être érigée au-dessus de 3 étages. Ici on en compte déjà 4. Et les maisons se sont effondrées comme des châteaux de cartes. Par ailleurs, les suivis de chantiers sont rarement effectués et les futurs propriétaires, une fois le plan de leur maison en poche, se tournent vers des entrepreneurs qui réaliseront les travaux, sans l’œil averti des professionnels».
Nous rencontrons enfin un groupe d’hommes qui viennent aussi se rendre compte de la situation, l’air grave. Ils m’expliquent que ce qu’ils craignent le plus c’est l’abandon de ce village par les habitants, découragés et peu désireux de continuer à investir dans une zone qui semble aujourd’hui maudite et depuis bien longtemps enclavée et abandonnée. Un hélicoptère tournoie au-dessus de nos têtes depuis une dizaine de minutes, tandis que des bateaux arrivent dans le port. «La préparation de la visite royale, commentent les hommes».
Le cœur névralgique de la ville d’Imzouren, outre le fronton sur la route et la place du marché est le lycée, qui donne son nom à ce quartier des enseignants, qui n’aurait jamais cru se voir un jour propulser à une échelle médiatique aussi intense. Quelques habitants s’y sont réfugiés également. Quelques mètres plus loin, un terrain vague accueille une dizaine de tentes de fortune, bricolées dans l’urgence ; couvertures, peaux de mouton, nattes tressées en osier ou en plastique se superposent, soutenues par des poutres, récupérées pour la plupart dans les gravats.
Mohamed El Hankouri, un conseiller communal rencontré au hasard de la visite m’indique que l’aide humanitaire existe bel et bien mais que la distribution est inégalement répartie. Tout en discutant avec lui, une espèce de forte bourrasque nous secoue : je viens de vivre la première réplique sismique, ce que je ne compris qu’en voyant mes interlocuteurs effectuer un saut au milieu de la rue. Il est 16h50.
Samedi 28 février 04
Ce matin, je vais me rendre dans les petits villages pour me rendre compte de la situation. J’accompagne un groupe de citoyens qui se sont organisés, depuis le tremblement de terre, et ravitaille les villageois des douars éloignés qui n’ont pas été sous les projecteurs des médias. Le comité spontané attend ce matin un camion de Tanger chargé de vivres, de chaussures et de vêtements neufs. Le rendez-vous est fixé à hauteur de l’entrée de la ville de Al Hoceïma, surnommé «contrôle», de par la présence permanente de la gendarmerie royale. En attendant dans la voiture l’arrivée du camion, je suis attirée par une foule nombreuse qui se masse devant l’entrée du Cercle Beni Ouriaghel. Curieuse, je traverse et pénètre dans le Cercle. A l’intérieur, dans un camion chargé de farine, un homme agite un sac en plastique rempli de cartes d’identité nationale, tandis qu’autour de lui, des hommes se pressent en hurlant à s’époumoner. C’est à ce moment que les «organisateurs», visiblement dépassés, décident de dresser un périmètre autour du camion, ce qui ne fait qu’augmenter la pression et les hurlements. Je demande à un jeune homme de répondre à quelques questions. Sans hésitation, il m’emboîte le pas et nous sortons du Cercle où il est bien évidemment impossible de s’entendre. Le jeune homme, répond à mes questions *, excité, d’une traite, le souffle souvent coupé par l’émotion :
«Le peuple veut de la literie, des tentes. On nous envoie de la farine et de l’huile. Nous, nous ne voulons ni farine, ni huile. Nous voulons un endroit où nous abriter. Une camionnette pour tous les habitants de Souani et d’Ajdir, c’est insuffisant. Les gens, comme vous l’avez vu, se disputent entre eux. Là (ndlr : endroit de la distribution), il y a des choses qui ne vont pas : les gens s’insultent et se disputent.
– Qu’est-ce qu’on vous distribue ?
– On distribue maintenant de la farine. En bas, il paraît qu’il y a une distribution de sucre, de farine et d’huile.
– J’ai vu qu’on vous avait enlevé vos cartes d’identité ? Est-ce exact? Pourquoi ?
– Oui, hier, ils ont ramassé les cartes d’identité pour assurer la distribution ce matin. Mais il y a un manque d’organisation et c’est la pagaille.
– Vous avez remis votre carte d’identité hier et vous ne l’avez toujours pas récupéré aujourd’hui ?
– Non.
– Que voulez-vous maintenant ?
– Je veux de la farine et de l’huile. Il y a cinq membres dans ma famille et je viens d’Ajdir. Je suis ici depuis ce matin très tôt (ndlr : l’interview se déroule à 9 heures, heure locale).
– Que pensez-vous de tout cela ?
– J’attends des membres de la Commune de Aït Youssef Ou Ali et de son Président qu’ils viennent sur place et qu’ils organisent tout ceci. Nous n’avons encore vu aucun d’entre eux. Nous avons contacté le wali qui nous a promis de nous envoyer des denrées alimentaires mais nous n’avons toujours rien vu (ndlr : j’ai essayé de joindre en vain les élus locaux dont il est question ici)».
Entre-temps le camion tangérois est arrivé et le convoi se dirige vers le douar d’Aït Abdelaziz, une petite localité qui dépend de la commune rurale de Aït Youssef Ou Ali. Un vieux monsieur, me voyant arriver, veut me servir de guide et m’explique * :
– Nous RIEN, absolument RIEN ! Le «makhzen» (ndlr : terme utilisé couramment pour désigner l’Etat et toute autre autorité) ne nous a rien apporté. La seule aide que nous avons eue est celle des citoyens. Cependant, le «makhzen» nous a apporté peu de choses, quelques boîtes de tomates, des pâtes, des haricots secs. Que voulez-vous que nous fassions avec cela ? Nous avons aussi reçu quelques couvertures pour enfants (une quinzaine) et une dizaine de petites tentes, sans armatures. Voilà ce que nous avons reçu par le biais de deux hélicoptères.
– Quand avez-vous reçu cela ?
– Hier (ndlr : le vendredi 27 février 04), en fin de matinée. Si ce n’était pas l’aide citoyenne, nos enfants seraient abandonnés à leur sort. Nous sommes dans un grand désarroi, nous vivons dehors depuis 5 jours maintenant. Le «makhzen» ne nous a guère considérés.
Des femmes légèrement vêtues et des enfants grelottant de froid se pressent l’un contre l’autre, devant des habitations dérisoires. Tout autour d’eux des maisons entières sont effondrées. Quant aux hommes, ils s’affairent devant un camion transportant des vivres et des couvertures. Un groupe de jeunes femmes m’accompagnent et me montrent ce qu’il reste de leurs maisons. De toute une vie, il ne reste rien, plus rien… Seulement quelques objets, témoignant du passage d’une famille décimée, comme ce couffin d’un bébé de mois …. Ou cette montre qui semble avoir rendu l’âme, elle aussi à 2h30, comme en attestent ses aiguilles…
Un petit enfant me montre une fosse, de laquelle, me dit-il, des voisins, aidés de volontaires, venus de la ville, ont dégagé son oncle. Devant une maison détruite, une immense place de terre fraîche accueille désormais les 33 sépultures des victimes du séisme. Faute de mains disponibles pour transporter les morts et les enterrer dans le cimetière situé en contrebas, les personnes décédées on été enterrées dans une fosse commune. Une jeune femme s’indigne * «nous aurions voulu enterrer nos morts dans le cimetière du village mais on nous a dit que le tracteur ne pouvait arriver jusque là » tandis qu’un homme du village tempère «il faut comprendre qu’il n’était pas possible de creuser 33 tombes. Il a fallu parer à l’urgence. Ceci dit, je précise que le tremblement de terre a eu lieu à 2h30 du matin et on n’a vu arriver le tracteur qu’à 11h30. C’est ça les secours ? Des secours dignes de ce nom doivent arriver au bout d’un quart d’heure, d’une demi-heure… Même s’ils sont venus secourir c’était trop tard. Ils n’ont pu qu’enterrer les gens dans une fosse commune».
Mon vieux guide, quant à lui, puise à nouveau dans ses souvenirs et interrompt ses voisins : «On a entendu des gens crier de sous les décombres mais nous n’avions pas les moyens de leur venir en aide. Après, il y a eu d’autres secousses, d’autres effondrements et les cris se sont éteints».
Les jeunes femmes, dans une dignité exemplaire, racontent, dans les menus détails, les moments cauchemardesques qu’elles ont vécu dans la nuit de lundi à mardi, procédant elles-mêmes au sauvetage de leurs proches, dans l’obscurité la plus totale, leur hameau étant démuni d’électricité. «Ma sœur a fait sortir ses enfants et son mari, qui a eu un malaise, par cette fenêtre avant de quitter à son tour la maison», m’explique Khadouje *, une autre habitante, en m’indiquant la pièce en question, avachie sur elle-même.
Dans un sanglot, elle explique : «mes deux sœurs sont actuellement à l’hôpital à Al Hoceïma. Nous n’avons pas eu la possibilité d’aller les voir. L’une de mes sœurs, mariée depuis un an et demi vient de perdre son bébé de 7 mois. Le couffin que vous voyez ici est le sien».
Les femmes expliquent qu’elles ont encore une immense peur «dans le cœur». «Chaque fois que la terre tremble, nous avons peur. De plus, nous sommes sales, nous ne nous sommes plus lavées depuis le tremblement de terre. Nous n’avons pas changé de vêtement non plus puisque toutes nos affaires sont sous les décombres. Tout est enterré. Parents, meubles, vêtements…».*
En quittant les lieux, une jeune fille se met à hurler : «Merci à notre peuple de nous avoir aidé. Ils nous ont procuré des vivres, des couvertures. Même si nous sommes encore démunis et que les hommes ici dorment sur des sacs de toile (ndlr : les sacs en toile de jute qui servent à contenir la farine, le sucre, le blé… sont souvent utilisés, dans les campagnes comme serpillières). Maintenant, nous avons enterré nos morts et nous devons penser aux vivants. Nos enfants et nous-mêmes sommes malades car nous avons attrapé froid. Nous avons toujours été oubliés et nous subissons à présent le tremblement de terre. Nous n’avons ni eau, ni électricité et maintenant nous sommes réduits à l’état d’animaux. Où habiter ? Comment vivre ? Notre seul espoir est le Roi ! Nous espérons qu’il nous aidera».*
Son cri de désespoir est insoutenable et l’ensemble des personnes sur les lieux s’en vont, en essuyant leurs larmes. Nous allons à présent nous rendre dans un autre douar montagnard, à Tizaghine, plus exactement. Devant nous, les mêmes scènes de cohorte de véhicules privés, venus apporter de l’aide aux sinistrés. A l’entrée du douar, un drapeau espagnol flotte sur une tente. C’est l’aide humanitaire, en provenance d’Espagne, qui a dressé ici son quartier général. Quelques mètres plus loin, on constate l’ampleur des dégâts devant le spectacle des maisons éventrées, dans ce village qui semble désert et mort.
Le cimetière du village est entièrement encerclé de ronces, ce qui signifie de nouvelles tombes. Un homme s’y recueille ; en pleurs, il nous livre qu’il pleure «ses morts».
Un peu plus loin, derrière quelques maisons détruites, je vois une famille, installée devant une petite tente. Ils prennent le thé et m’en proposent bien gentiment. «Tu as faim ? Tu veux manger ?».* Je suis épatée par l’accueil chaleureux, la générosité, l’envie de partager le peu qu’ils possèdent. Une femme de la famille m’informe que 8 de leurs voisins sont morts et aussi qu’ici «ils ne manquent de rien». «Nous recevons tous les jours du pain, du lait et hier, vendredi, nous avons reçu quelques tentes». *
Dans ce village électrifié depuis quelques années mais où les villageois sont toujours démunis d’eau courante, la vie s’est arrêtée, toutes les maisons ont été désertées, les enfants ne vont plus à l’école. «Nous ne faisons plus rien. Nous sommes tous dehors, inactifs. La terre a encore tremblé, à de nombreuses reprises, depuis la violente secousse. Nous avons peur, nous sommes perdus. Dès que la terre tremble notre cœur faiblit. Il a plu aussi et nous n’avions pas encore de tentes puisqu’elles n’ont été installées qu’hier par des Espagnols. Nous n’avons même pas de vêtements puisqu’ils sont ensevelis. Nous avons tout perdu».
Tout en invitant les femmes de sa famille à témoigner, une vieille dame plaisante : «je vais laisser les jeunes parler car moi je suis trop vieille».* Une autre membre de la famille se met alors aussi à expliquer : «Quand la nuit tombe, on ne souhaite qu’une chose c’est de voir le jour se lever. Nous avons peur la nuit tandis que la journée nous sommes dehors, nous voyons ce qui se passe. Quand la terre tremble la panique s’empare de nous». *
«Tu as déjà senti la terre bouger ?» me demande ma première interlocutrice. Je lui réponds que j’ai senti quelques répliques depuis mon arrivée hier. «Ca ce n’est rien, me répond-t-elle. Ce sont de petites secousses. Mardi matin c’était effrayant ! Jamais nous n’avons vécu cela».
Ici aussi les habitants n’ont pas pu compter sur les secours. «Nous avons nous-mêmes sorti nos voisins des décombres ainsi que les cadavres. A l’arrière, il y a une odeur insupportable due aux cadavres d’animaux qui se trouvent encore sous les gravats».
Les femmes, inquiètes pour leur avenir, confient «nous ne pouvons rester indéfiniment sous les tentes. Avec l’arrivée de la chaleur, nous serons très rapidement chassés par les scorpions et les serpents».
A Aït Hicham, une bourgade de Aït Youssef Ou Ali, fortement touchée par le séisme, l’heure est aussi à l’organisation. Un responsable local, El Ghabzouri Haddi explique que la mise sur pied d’un comité organisationnel a été incontournable, devant l’ampleur de la pagaille ambiante. «Nous avons connu quelques mésaventures, ici, mercredi. Un camion a été pris d’assaut par des personnes étrangères au douar et cela donne, de nous, une très mauvaise image, à l’extérieur. Aujourd’hui nous avons dissocié trois catégories d’habitants ; ceux de la ville, ceux de la Mosquée et ceux de «contrôle». Chacun de ces trois groupes d’habitants sera desservi séparément». *
De retour en ville, l’effervescence est toujours de guise. Les camions de «la chaîne de solidarité» ne cessent d’affluer, bondés de victuailles et de matériels divers et toujours drapés dans leur calicot indiquant leur ville d’origine.
Je n’ai pas eu accès à l’hôpital Mohammed V, ce matin et ce début d’après-midi pour cause de visite royale. Le Docteur Mohamed Salhi, directeur-médecin de la clinique Bades me téléphone pour m’inviter à la visite de l’hôpital. Nous y sommes reçus par le Docteur Chakibi Abdelradim. Outre la petite tension qui semble encore subsister après la visite royale, «il n’y a plus de problèmes», confie notre hôte. Le «plus de problèmes» est certainement à relativiser, en regard de l’intense activité et gestion de l’urgence qui ont prévalus jusqu’à cette matinée. «Nous avons opéré 26 blessés, qui sont arrivés dans un état très grave dont trois hémorragies internes». Et pour terminer la liste froide des chiffres, on peut ajouter qu’ici à l’hôpital d’Al Hoceïma, quelques 620 blessés ont été admis dont 121 sont encore entre les murs et 14 autres, gravement blessés ont été évacués sur l’hôpital militaire Mohammed V à Rabat, le CHU Ibn Sina (Avicennes) de Rabat et une clinique privée à Nador. Par ailleurs, l’hôpital Mohammed V, d’une capacité totale de 330 lits s’est vu renforcer par le dispensaire, l’orphelinat et un hôpital militaire de campagne spécialement dressé à Imzouren. A ce manque de lits, les médecins sont confrontés aujourd’hui à un autre problème épineux : celui des patients qui ne veulent plus quitter l’hôpital, pour des raisons non pas médicales mais simplement psychologiques, estimant certainement qu’ici ils sont en sécurité.
Avant de nous faire visiter l’aile chirurgicale réservée aux femmes, le docteur Chakibi nous donne encore quelques informations générales. «Pour le moment les patients sont pris en charge à tous les niveaux, tant médical que psychologique car nous avons des personnes qui ont perdu plusieurs membres de leur famille. Les véhicules privés ont ramenés 32 personnes à l’hôpital, contre 28 transportés par ambulance. Ceci vous donne une indication des secours sur lesquels la population a pu compter. Heureusement que les blessés ont bénéficié de l’élan de solidarité des voisins et autres qui ont mobilisés, qui leur taxi, qui leur camionnette, qui leur voiture… Je n’ai pas encore de chiffres exacts mais je sais que durant les six premières heures après la secousse, nous avons reçu de nombreux blessés. De nombreux blessés sont certainement décédés faute de secours, ce qui explique que le nombre de blessés et quasi identique à celui des morts. Non, vraiment les secours n’étaient vraiment pas de haut niveau ! Je peux l’affirmer dire quand j’ai vu des gens arriver à pied, après une marche de 5 kilomètres, avec une porte faisant office de civière».
Aïcha Moussaoui, une femme, âgée d’une cinquantaine d’années, originaire de Imzouren a été sauvée in extremis par son fils et a perdu 4 enfants, sa petite-fille et son époux. «Elle est arrivée à 4 h du matin, soit 1 heure 30 après le séisme, dans un véhicule privé. Pourtant elle habite à Imzouren, à quelques kilomètres d’ici et les routes sont praticables, soupire le Docteur Chakibi».
Son fils, qui, avec sa mère, est le seul survivant de la famille, n’a eu la vie sauve que grâce à une demande de visa effectuée à Rabat. Lors du tremblement de terre, il était dehors pour se rendre à Nador, avant de se diriger vers la capitale. Ce qui lui vaudra non seulement la vie sauve mais lui permettra de revenir sortir des décombres son père et sa mère. Pour ses frères il est malheureusement déjà trop tard. Quant à son père, il perdra la vie à l’hôpital. Comme pour mieux réaliser lui-même ce qui lui est arrivé, il sort de sa poche la convocation salvatrice et nous la montre. «Regardez, la date du rendez-vous était bien fixée au 24!». *
Le Docteur Chakibi est appelé aux urgences et passe la main à son collègue le Docteur Azzouzi Abderrahim. «Me permettez-vous de vous inviter à boire un café à la cafétaria ? Je n’ai rien mangé depuis ce matin et un café me ferait le plus grand bien !».
Avant de lui emboîter le pas, il est happé par deux hommes, inquiets, qui lui demandent des nouvelles. Il répond patiemment et nous rejoint. «Comme vous le voyez, les gens sont angoissés et traumatisés. Nous devons aussi gérer les visites intempestives, les membres des familles qui arrivent, à toute heure du jour et de la nuit pour s’enquérir de la santé ou de la vie d’un proche». Légitime mais épuisant pour le personnel soignant sur les dents depuis la nuit du séisme.
La tasse de café servie, la cigarette allumée, le Docteur Azzouzi se plie à l’exercice : «Aujourd’hui nous n’avons pratiquement plus de problèmes, c’est-à-dire que les malades qui avaient besoin d’être opérés l’ont été, ceux qui avaient besoin d’être soignés l’ont été, ceux qui avaient besoin d’être évacués vers d’autres hôpitaux l’ont été. Jusqu’au troisième jour, nous n’avons pratiquement reçu que des sinistrés mais depuis les choses se sont normalisées et nous recevons à présent de la pathologie ordinaire. La vie reprend son cours sauf que comme il y a eu quatre jours d’activités intenses, cela se fait avec un peu de difficulté. Les moyens ayant été concentrés sur l’urgence commencent à se faire sentir, les lits d’hospitalisation se font à nouveau rares». A la question de savoir comment faire sortir de l’hôpital les patients qui n’ont plus besoin de soins, le médecin répond, sincèrement : «Je ne sais pas. Le problème qui se pose c’est que les personnes qui peuvent sortir risquent de ne pas trouver d’endroits où ils peuvent être pris en charge. N’oublions pas que des personnes ici ont perdu toute leur famille. C’est un problème très grave. Je ne pense pas que jusqu’à présent on y ait véritablement pensé et réfléchi de manière sérieuse. Moi même je ne sais pas comment gérer ces sorties».
Ce tremblement de terre, véritable drame humain permettra-t-il à tout un chacun de tirer des leçons et des enseignements, à tous les niveaux, quant à la prise en charge des sinistrés, l’organisation des premiers secours ? Ici, à l’hôpital, le docteur Azzouzi certifie que c’est le cas. «On n’est certainement loin d’être parés pour vivre ce genre de situation. Tout ce qui a été fait l’a été fait dans l’improvisation. Quand une catastrophe de ce genre survient, tous les moyens doivent être mobilisables très vite. Ce n’était pas le cas. Les choses se sont faites grâce à la mobilisation de tout un chacun, sans plan pouvant faire face à un afflux massif de sinistrés».
Et de manière structurelle, la question inévitable est celle de la réhabilitation de la région, zone enclavée et oubliée des autorités depuis des décennies, de la qualité de ses routes, de l’infrastructure existante. Là aussi la question fuse, rapide : «Personne ne peut prétendre que l’infrastructure -pas seulement hospitalière- est suffisante. Cette région est très démunie en infrastructure sanitaire même si globalement le domaine de la santé, par rapport à la catastrophe, a peut-être été celui qui a réagi avec le plus de célérité et d’efficacité. Il n’empêche que c’est insuffisant. On a dû procéder à des évacuations, avec tous les problèmes que cela pose, uniquement par manque de moyens d’investigation. Nous n’avons pas de scanner, par exemple. Mais enfin, il vient d’arriver ! Quand on parle de structures sanitaires, il ne s’agit pas seulement de l’hospitalier, cela inclut aussi des unités mobiles de secours, de réanimation…Même si cela existait, compte tenu de la vétusté de la voirie, de l’inexistence des routes, peut-être tout cela n’aurait pas servi à grand chose».
Nous prenons congé du docteur Azzouzi et nous rendons, avec le docteur Salhi, en pédiatrie. Dans cette chambre logent 6 enfants, dont 2 totalement orphelins. Leïla, magnifique petite fille rousse, âgée de 7 ans, nous gratifie d’un lumineux sourire innocent. Une voisine, à peine plus âgée qu’elle, assise à son chevet explique que Leïla a perdu toute sa famille. Dans la rangée d’en face, trois enfants d’une même fratrie nous expliquent qu’ils ont perdu leurs parents et un de leur frère.
Dimanche 29 février
Ce matin, je descends à Sabadia, une des plages de Al Hoceïma où un camp a été dressé, par les soins d’une unité belge. Dans les tentes, les femmes préparent le petit déjeuner. Zohra, une maman, d’une quarantaine d’années, dont les enfants dorment encore à l’intérieur, vient de revenir de la ville où elle a été recueillir quelques affaires de sa maison.
Dans un français presque impeccable elle raconte, à son tour, ses déboires et malheurs : «A deux heures et demie, nous dormions tous quand tout à coup, quelque chose de très fort nous a réveillés. Les enfants pensaient qu’ils rêvaient. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je suis cependant très contente de pouvoir bénéficier d’une tente, grâce aux Belges. Beaucoup n’ont pas cette chance. Les enfants ont toujours très peur et nous ne pouvons pas rentrer à la maison. Nous passons tous la nuit dehors et il fait très froid. Il nous manque des couvertures et de la nourriture. Moi j’ai quatre enfants, j’ai perdu mon mari depuis 13 ans et c’est très difficile pour moi. Je lance un appel au monde entier d’aider, même de la manière la plus minime, les gens qui vivent de véritables drames, comme à Imzouren, par exemple».
Dans le camp «belge», le Colonel Eddy Lapon, un «pro» des tremblements de terre qui a déjà assuré l’aide aux populations à El Asnam (Algérie) et Bam (Iran) fait le tour et vérifie la solidité des tentes, menacées par un vent violent qui souffle. Le Colonel Lapon et son équipe sont arrivés à Al Hoceïma, le mardi, jour du séisme après avoir pris contact avec un responsable de la Protection Civile qui l’a envoyé vers le wali. «Après avoir obtenu les autorisations d’usage, on a déployé ici 100 tentes familiales qui abritent aujourd’hui environ 500 personnes. Puis on nous a demandé de monter un deuxième site, à quelques mètres plus loin, mais on n’a pas pu le faire car les camions ont été bloqués par la population, des gens qui voulaient une tente individuelle. Cela se passait le mercredi dernier. Jeudi, un avion est arrivé avec 300 tentes et j’ai distribué moi-même ces tentes dans des montagnes, près de Tetouan. On a réussi à fournir des tentes à tout un village là-bas. Nous avons organisé ces camps mais demain nous partons et nous remettons la gestion et l’intendance de ces camps aux autorités municipales. La population ici s’est auto-organisée et une dizaine de personnes gèrent le camp». Est-ce à dire que la Belgique n’assurera plus aucun suivi, une fois les responsables partis ? «Normalement, notre mission s’arrête ici mais je sais qu’il y a encore un avion belge qui va arriver avec un autre chargement de tentes et de vêtements, récoltés par des associations marocaines en Belgique».
Et le conseil final du Colonel Lapon qui a vécu avec la population locale depuis près d’une semaine est la suivante : «Les gens ont peur de retourner à l’intérieur de leurs maisons, même si elles n’ont pas été touchées par le tremblement de terre. Il y a encore de nombreuses répliques, ce qui n’incite pas au retour à domicile. Les autres pays devraient faire comme la Belgique et envoyer des tentes, des couvertures et des vêtements pour laisser vivre les gens convenablement dehors. Les répliques d’un tremblement de terre peuvent durer 2 à 3 semaines et tant que ces répliques n’ont pas cessées, les gens ne rentreront pas chez eux».
Sur la route, nous rencontrons Hassan Saihi, un immigré espagnol, arrivé de Malaga, avec une camionnette remplie de tentes, de lampes de poche et de sacs de couchage. Il va se rendre dans les montagnes, à Tafrast et à Zaouia Sidi Youssef.
A Tafrast, Hassan est très rapidement rejoint par un convoi impressionnant, en provenance de Nador, avec à son bord, une troupe de scouts, joyeux et dynamiques. Très vite, la place de la mosquée prend des allures de fête. Le déchargement dans la salle de la mosquée qui sert de dépôt collectif se fait en chansons ponctuées par de stridents coups de sifflets. On en oublie quelque peu le drame survenu il y a quelques jours…
Je continue ma tournée rurale en mettant le cap sur Imhaoulen, au-dessus duquel tournoie, dans un champ, un hélicoptère de la gendarmerie royale. Dans un vrombissement d’enfer, il se pose au sol, pendant que des villageois, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux accourent, de toute part.
Les enfants s’agglutinent autour de l’hélicoptère duquel des hommes déchargent, à même le sol, quelques couvertures, quelques tentes et quelques sacs blancs contenant probablement des denrées alimentaires. Je laisse les habitants du village à leur distribution et prend la route de Zaouia Sidi Youssef, toute proche. Là aussi, même scène de distribution et de solidarité. J’accoste un habitant, Hamadi Boutahar, âgé de 46 ans qui revient de la distribution, transportant un sac contenant du pain, deux couvertures, de l’huile, du lait et quelques mètres de plastique. Il n’a perdu aucun membre de sa famille mais sa maison a été détruite et son troupeau décimé. «Nous vivons des jours noirs depuis mardi dernier. La pluie, le froid et la faim sont notre lot quotidien. Ce sont des citoyens, venus de Melilla, de Nador, de Tanger qui nous ont aidé depuis le tremblement de terre. Nous leur en sommes reconnaissants».
Lorsque je lui fais part de l’hélicoptère qui vient de se poser, à quelques centaines de mètres, il ajoute : «Oui, effectivement, il y a deux ou trois hélicoptères qui sont venus dans notre région mais tout le monde n’a pas pu bénéficier de l’aide. Ils ont lâché les produits et puis sont repartis. Ici, c’est différent. Allez voir l’organisation. Elle est assurée par l’imam de la mosquée, sous la surveillance des personnes qui viennent nous apporter l’aide alimentaire ou autre».
Je prends congé de ce patelin rural qui clôturera ma courte visite. Il est bientôt 18 heures, l’heure de mon rendez-vous avec la Coordination des Associations d’Al Hoceïma. Dans le local de l’Association Marocaine des Droits de l’Homme, les représentants de différentes associations -plus particulièrement des associations de développement local, de femmes, de défense des droits humains- composant la Coordination prennent place autour de la table. Depuis mercredi dernier, conscients que l’union fait la force, une quarantaine d’associations sont tombées d’accord pour la création d’une structure les regroupant, chargée de défendre les intérêts des sinistrés.
Lemhallem Omar, membre de la Coordination décrit la genèse de la création de leur nouvelle structure. «Mardi, après le tremblement de terre, nous nous sommes rendus compte de l’ampleur des dégâts. Enormément de dégâts matériels mais aussi de lourdes pertes humaines. Nous avons alors convoqué une dizaine d’associations -nous sommes aujourd’hui 39- et nous sommes fixés deux missions. La première, celle de parer à l’urgence et de secourir les gens, en leur fournissant toute l’aide nécessaire, en ce compris l’acheminement de vivres, de matériel de première nécessité, de médicaments. La seconde mission est de penser déjà à la reconstruction. Nous avons mis sur pied un secrétariat, composé de 9 membres, un comité de permanents, chargé d’accueillir les gens qui viennent à l’association, un comité d’information et des coordinateurs pour chaque petit village, chargés de nous informer, de recueillir des données qui nous permettront d’avoir des données statistiques claires pour envisager toute politique sociale, de logement, d’aide… ultérieure».* La Coordination a aussi rédigé de multiples communiqués à l’attention des médias ainsi que des appels à la solidarité citoyenne. Par ailleurs, Omar se plaint aussi de la distribution des tentes qui devaient, en priorité être acheminées vers les villages ruraux, fortement touchés par le séisme.
Saïd El Farissi enchaîne sur le rôle de «l’Etat» qu’il juge extrêmement faible et surtout dans les trois jours qui ont suivi le tremblement de terre. «Le drame qu’ont vécu les habitants des villages ruraux est principalement dû au manque de routes praticables. De plus, la médiatisation s’est faite surtout autour de Aït Kamra et d’Imzouren. Alors que d’autres douars ont été touchés de manière encore plus dramatique». Saïd estime que la responsabilité de «l’Etat» est engagée depuis 94, date du précédent tremblement de terre. «La zone d’Al Hoceïma est une zone rouge et devait être considérée comme telle. Ce ne fut pas le cas». *
De leur côté, Zohra Koubi’r et Jamila Soussi, tiennent à attirer l’attention sur le sort des femmes, particulièrement touchées par le drame.
«Nous ne faisons bien sûr pas de distinction entre les hommes et les femmes, mais cependant nous avons constaté que de nombreuses femmes se sacrifient et préfèrent rester dans le village, alors qu’elles méritent des soins. Nous avons vu une femme qui avait les ongles arrachés et qui n’avait reçu aucun soin. Les hommes peuvent se déplacer, seuls et aller se faire soigner. Pour une femme c’est impossible, elle doit être accompagnée».
Dans ces régions, très conservatrices à l’égard des femmes, Zohra et Jamila constatent que de nombreuses femmes sont harcelées dehors. «Elles se plaignent de l’attitude des hommes, des militaires, qui les harcèlent et sont choquées par ces comportements, inadmissibles, surtout dans une période aussi douloureuse que celle-ci».*
Omar Moussa Abdallah, quant à lui, est chargé des relations avec les autorités et les institutions officielles. Il se plaint de la lenteur des autorités qui n’a convoqué les associations locales que jeudi dernier, pour une réunion avec la Fondation Mohamed V. Lenteur, retard, encore et toujours…
Quelques réflexions…
Vivre trois journées au quotidien le drame d’une population, c’est peu, bien peu. Tout en connaissant la région du Nord, dont je suis originaire, je n’aurai cependant nullement la prétention de prétendre avoir une photographie complète et exacte de la situation.
Cependant, forte des témoignages que j’ai rassemblés durant ces trois intenses journée, je me permets de livrer, à qui veut les lire, quelques réflexions. Subjectives certainement, sincères réellement…
J’ai été frappée par la solidarité spontanée des citoyens marocains qui ont, avec brio, aidé les plus démunis à s’abriter, même de manière sommaire, à s’alimenter, à se soigner, à enterrer les victimes, alors que les autorités tant locales que les autres ne sont arrivés qu’après trois ou quatre jours. Souvent trop tard… ou, sous les feux des projecteurs, dans des mises en scène frisant le ridicule mais surtout indécentes.
Je reste admirative devant le travail des associations, des volontaires qui se sont mobilisés, dès les premiers instants du drame, vaquant à l’urgence tout en s’interrogeant sur la construction du futur.
Quant aux femmes, longtemps reléguées au ban de la société marocaine, elles ont à nouveau prouvé combien elles sont efficaces dans leur capacité de mobilisation, d’organisation et d’intendance. Osons espérer que les hommes de la contrée, connus pour leur esprit conservateur, «lâcheront la bride traditionnelle» et reconnaîtront que les femmes, à leur côté, constituent une force et non une menace. Ces femmes remarquables doivent être soutenues et bénéficier d’instruments qui leur permettent d’appréhender leur environnement de manière globale. Pour ce faire, l’alphabétisation et l’accès au savoir sont deux vecteurs d’émancipation qu’il ne convient plus de remettre en question. Or, si de nombreuses personnes (hommes et femmes) se sont vues coupées de ce droit, la proportion la plus grande se retrouve dans la gent féminine et plus particulièrement dans les zones rurales.
Comme le soulignaient Zohra et Jamila, le tremblement de terre a mis en exergue un phénomène connu : en tant de crise, en tant de guerres, ce sont toujours les femmes qui paient le plus lourd tribut. Dans les zones rurales, même dans des périodes hors crises, les problèmes se posent toujours en termes plus aigus pour les femmes, de par leurs conditions de vie. Des femmes perdent encore aujourd’hui la vie, des suites d’accouchements car les routes sont inexistantes pour pouvoir les transporter à l’hôpital, elles ne sont pas scolarisées car elles sont soumises à des tâches pénibles comme celle, par exemple, de faire plusieurs kilomètres par jour pour s’approvisionner en eau. Ces femmes rurales ne peuvent plus être les oubliées des programmes de coopération et de développement. Elles doivent être formées afin de devenir à leur tour des actrices de changements et des relais au sein de leur douar, village, région.
Comme je l’ai souvent affirmé, je suis loin d’être une indépendantiste, aspirant à une indépendance géographique ou politique du Rif. Tout en plaidant pour un Maroc uni et unifié, j’aspire cependant à ce que chaque citoyen puisse jouir pleinement de la faculté d’exercer son droit à parler la langue qu’il souhaite, se référer à sa culture et surtout ne pas vivre une marginalisation en fonction de son appartenance. Je continuerai à défendre ce principe, avec toutes les forces vives qui défendent les mêmes valeurs, sans ostracisme et sans tomber dans un discours régionaliste et réduit à leur seule «communauté».
Le tremblement de terre d’Al Hoceïma restera à coup sûr dans les annales «noires» de l’histoire du Maroc. Que les nombreux morts ne soient pas partis «pour rien» et que l’entièreté des décideurs politiques utilisent ce drame pour tirer un bilan honnête et surtout pour formuler une politique de décentralisation de toutes les contrées enclavées. Une politique basée sur la proximité locale, avec des élus locaux, jouissant de pleins pouvoirs et non en attente perpétuelle des ordres «d’en haut» ou «d’en bas» -c’est selon- est le pilier essentiel de la démocratie.
L’objectif à atteindre est celui de rendre à tous les citoyens et citoyennes marocain(e)s, la reconnaissance à laquelle ils ont droit. Toutes les régions du Maroc, du Nord au Sud, doivent être traitées comme des régions du Maroc à part entière et non comme des petites annexes insignifiantes.
Fatiha SAIDI,
Al Hoceïma,
* Les interviews signalées par l’astérisque ont été réalisées en rifain et traduites par mes soins.
Pour toute information complémentaire ou pour obtenir les photos :
fatiha.saidi@ibelgique.com